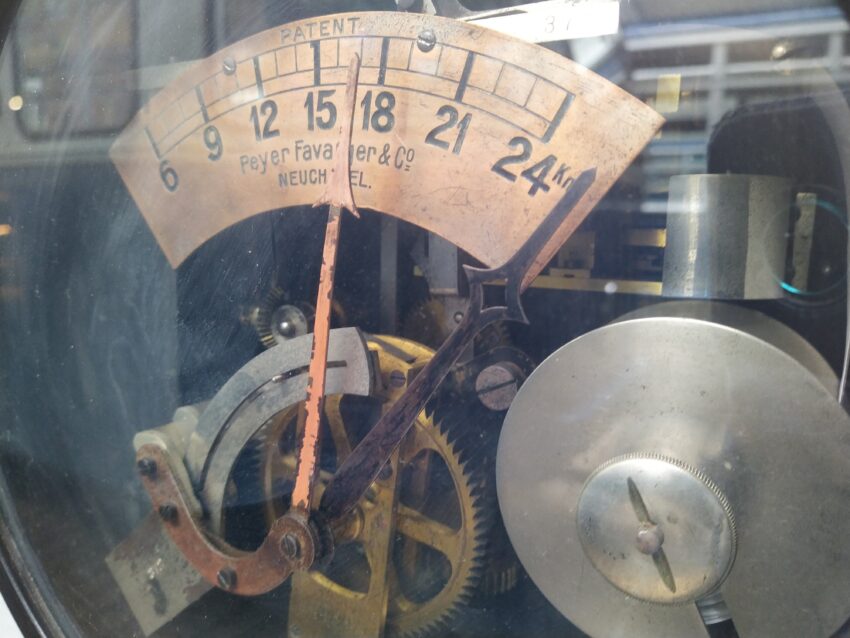J’étais arrivé par le train de l’après-midi dans la ville de xxxx. Mon journal m’y avait envoyé couvrir la foire agricole, la plus importante du département, qui se tenait pour la première fois depuis la guerre. J’allais rester deux jours pour suivre l’événement et prendre des photos. Il n’y avait là rien de bien excitant, mais il fallait bien gagner son pain.
Je venais de prendre une chambre à l’auberge de l’Aigle, une bâtisse à colombages du 17e siècle, qui se dressait au coin nord de la place du marché. Une fois mes bagages installés dans ma chambre, je descendis dans la salle à boire pour prendre un verre et la température des lieux. Le patron était de service, un petit gaillard jovial aux joues creuses et au crâne poli comme un galet. Nous nous trouvions avant le coup de feu, et il était tout disposé à me donner un aperçu de la bourgade. En trois quarts d’heure, il m’avait brossé un bon portrait, partageant même quelques histoires saugrenues du coin.
Le patron me servit un second demi, puis me désigna du menton le client qui venait de passer la porte.
— Le voilà notre savant, le drôle dont je vous parlais, dit-il. Toujours à la même heure, réglé comme du papier à musique.
J’observai le nouveau venu d’un œil curieux. C’était un grand escogriffe, vêtue d’une veste élimée trop courte qui laissait apparaître des poignets blancs et graciles. Il ne portait pas de chapeau ; une raie partageait ses cheveux lisses, d’une couleur gris cendre, en deux pans symétriques qui descendaient jusqu’à ses oreilles. Il portait des petites lunettes rondes, de celles qu’on acquière parce qu’on a lu trop de livres.
L’homme s’installa sans hésiter à une petite table dans le fond. Le patron lui apporta un verre de vin blanc ainsi que le journal local, qu’il posa devant lui. Le client le remercia d’un petit signe de tête, trempa ses lèvres dans le vin et ouvrit le journal.
Le patron revint s’installer derrière le comptoir.
— Il vient tous les jours. Depuis la mort de sa femme il n’a plus toute sa tête, le pauvre bougre. Maintenant il va parcourir le journal de la première à la dernière page.
Cela, bien sûr, n’avait rien d’exceptionnel. Mais le patron avait mentionné une étrangeté qui avait piqué ma curiosité. Un de ces détails qui semblait d’abord anodin, mais qui, pour un journaliste, signalait la possibilité d’une histoire.
Le bonhomme avait un accord avec le patron : celui-ci ne devait lui apporter que le journal de l’avant-veille, sans exception. Pourquoi cet intérêt pour un papier vieux de deux jours ? avais-je demandé. Le patron avait répondu avec un sourire en coin que je devrais lui demander moi-même, que je ne le regretterais pas.
Ainsi, je me décidai à faire connaissance avec le « savant », qui avait toujours le nez collé dans son journal tandis que je m’approchai de sa table. Vous permettez ? lui demandai-je en saisissant le dossier de la chaise en face de lui. Sans proférer un mot ni lever la tête, il m’adressa un signe de la main pour m’inviter à m’asseoir.
De plus près, l’homme dégageait une odeur de cardamome et de vieux livres. Il posa des yeux délavés sur moi :
— Eh bien, M. xxxx, que puis-je faire pour vous aujourd’hui ?
Je ne lui avais pas donné mon nom, j’étais donc surpris qu’il le connût. Sans doute le patron le lui avait soufflé en lui apportant sa commande. Je me présentai, journaliste en reportage pour le nouveau Dauphiné libéré, vétéran de la bataille de France dans la 7e armée, ayant passé la fin de la guerre en Allemagne pour le service du travail obligatoire. Mon vis-à-vis était âgé – soixante ans au minimum – et n’avait vraisemblablement pas été mobilisé. Il se présenta comme Julien Beausire, physicien atomiste.
Je l’interrogeai sur son étrange manie de lecture. Pourquoi les informations vieilles de deux jours ? Qu’y avait-il là d’intéressant ?
Il ajusta ses petites lunettes. Si je voulais connaître la réponse à cette question, me dit-il, il devait d’abord me parler de ses recherches. La foire agricole ne commençant que le lendemain, j’acquiesçai de bon cœur.
— Le passé, le futur… commença-t-il. La plupart des gens se fourvoient sur leurs natures, sur ce qu’ils ont en commun, et sur ce qui les différencient. Voyez-vous, si l’on y réfléchit bien, ils sont bien plus similaires qu’il n’apparaît de prime abord. Le futur sera ce qu’il sera, et en cela il n’est pas moins déterminé que le passé, bien au contraire.
Je ne voyais guère où il voulait en venir, mais je l’encourageai à continuer d’un hochement de tête.
— Tous les objets et les êtres possèdent une inertie propre qui les fait glisser du passé vers le futur. Cette polarité est universelle. Pourquoi cette direction que nous connaissons plutôt que son contraire ? Un hasard de la nature, sans doute, car nous aurions pu aussi bien nous accommoder d’un monde à la polarité temporelle inversée. Mais l’universalité de cette polarité ne signifie pas qu’elle soit irréversible… M. xxxx, êtes-vous familier avec les rayons N ?
Je connaissais cette histoire d’avant-guerre, lui dis-je. Les rayons N étaient la découverte du nancéen Blondlot, sur les pas des travaux de Röntgen. Mais contrairement aux rayons X, les rayons N s’étaient révélé une fumisterie, une affabulation, un aveuglement involontaire du pauvre Blondlot et des spectateurs qui avaient assisté à ses démonstrations. Bref, de la poudre aux yeux, et ma profession s’était ridiculisée en présentant trop vite René Blondlot comme le nouveau Pierre Curie.
Beausire eut une moue amusée.
— Pourtant, les rayons N existent bel et bien. Blondlot n’a pu prouver leur existence car il ignorait une composante fondamentale des rayons, ainsi qu’une nécessité technique pour rendre leur émission stable. Sans cette connaissance, les expériences de Blondlot ne pouvaient à terme qu’être vouées à l’échec. Néanmoins, j’avais toujours suspecté qu’il avait été jugé trop vite, mis au ban de la recherche en sciences physiques par la vindicte publique. Ses travaux d’origine ont ouvert une voie dans laquelle je me suis engouffré. Dans mon laboratoire, je suis parvenu à contrôler le flux de rayons N, à les mesurer, à les amplifier, à les canaliser, bref j’ai réussi des décennies plus tard là où Blondlot avait échoué. Les rayons N sont bien réels, et leurs effets dépassent l’imagination !
Pouvait-on croire un instant à ces élucubrations de vieil homme ? Je voulus savoir quand il avait selon lui réalisé cet exploit, accompli cette « découverte » douteuse, me disant qu’une telle affaire, si avérée, n’avait pu rester secrète. La réponse me prit par surprise :
— Dans un an et un mois, à quelques jours près, dit Beausire sans la moindre trace d’ironie.
Cette conversation prenait un tour grotesque, et pourtant je ne pouvais me résigner à quitter la table en prétextant quelque travail à finir pour mon article.
— L’irradiation par les rayons N, reprit Beausire, est capable d’inverser la polarité temporelle à laquelle vous, et à vrai dire tous les êtres sur Terre, sont soumis. Mais à laquelle moi, Julien Beausire, je ne suis plus soumis. Ou pour être exact, je suis maintenant soumis à la polarité inverse, qui me tire inextricablement dans la direction du passé. Depuis le jour où j’ai été irradié par les rayons N, le passé est devenu mon futur, et vice-versa.
— Mais c’est impossible, dis-je. Vous suggérez que vous venez du futur, mais celui-ci n’est pas encore écrit, c’est une abstraction, il n’existe pas !
— Oh, bien sûr que si. Le futur sera ce qu’il sera, je vous l’ai dit. Et quoi que vous puissiez penser ou faire n’y changera rien. Cependant, le pouvoir des rayons N m’a transformé de manière complète, sans retour. Ma polarité temporelle est inversée. Désormais, je me déplace à contre-temps.
Je décidai de jouer le jeu ; avec les fous, mieux valait garder son sérieux. Je le questionnai encore sur son étrange lubie de consulter l’édition de l’avant-veille. Il se rembrunit, soudain perdu dans ses pensées. Il attendait l’annonce d’un événement, finit-il par me dire, après un silence pesant. Je le pressai pour en savoir davantage, et il déballa son histoire. Hormis ses recherches, la seule chose qui comptât dans la vie de Beausire était sa femme, son adorée Anne-Cécile, qui était d’après le savant le charme et la délicatesse incarnés. Si Anne-Cécile n’avait jamais témoigné quelque intérêt que ce fût pour les sciences physiques, elle avait été d’une dévotion sans faille envers Beausire, le soutenant et l’épaulant dans tous ses efforts. Elle était sa boussole pointant le nord, sa cage de Faraday le protégeant des court-jus. Ou plutôt, elle avait été.
— Il y eut un terrible accident, dit Beausire.
Alors qu’Anne-Cécile revenait d’une visite chez des parents, elle avait péri broyée dans la collision de son train avec un transport de marchandises. Trente-trois autres personnes étaient mortes ce jour-là, dont douze femmes et trois enfants.
— La nouvelle a nécessairement été reportée dans le journal, continua le savant, mais je ne suis plus sûr de la date.
— Vous ne vous en souvenez pas ? demandai-je, ahuri. Il s’agit pourtant de votre femme.
Beausire réprima une grimace. Il m’expliqua que l’inversion de polarité temporelle avait fait naître des complications inattendues. Au fil des jours, le passé devenait pour lui flou, incertain, tandis que le futur se raffermissait. Certains souvenirs d’Anne-Cécile s’estompaient dans son esprit.
— Mais je sais que le jour viendra, dit Beausire. Il me suffit d’être patient. Je n’ai rien d’autre à faire.
— Que ferez-vous le moment venu ? demandai-je. Vous voulez empêcher la catastrophe ? Bloquer le train avant qu’il ne coure au désastre ?
— Oh non. Je ne peux rien y changer, dit Beausire avec un petit haussement d’épaules.
— Mais alors ? À quoi bon ?
— Lorsque je retrouverai Anne-Cécile, je l’irradierai avec les rayons N – je possède tout l’équipement nécessaire dans mon laboratoire. Une fois sa polarité temporelle inversée, nous reprendrons notre vie commune et nous ne nous quitterons plus. Un passé radieux nous attend.
Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, et je bus une gorgée de bière. Voilà qui aurait fait une bonne histoire pour un feuilleton de science-fiction ! Dommage que mon journal n’en publiât pas…
Nous échangeâmes encore quelques mots, puis Beausire avait finalement replongé le nez dans son canard, oublieux de ma présence. Je n’insistai pas et retournai au comptoir pour deviser avec le patron, ma tête encore pleine d’images extravagantes.
Ces images persistèrent, et ma nuit fut peuplée de rêves malsains, d’aiguilles d’horloges tournant à rebours, de rayons colorés sortant d’un tube à vide, si bien que je me réveillai plusieurs fois en sueur, vérifiant que la trotteuse de mon réveil avançait bien dans le sens habituel. Après une brève toilette et un petit-déjeuner frugal, je rejoignis les lieux de la foire agricole, dont l’ouverture officielle était ce matin-là. Je pris des photos, interviewai le président et les membres du comité d’organisation, discutai avec les visiteurs, qui se réjouissaient de la reprise de la foire. À la fin de la journée, j’avais plus de matériel qu’il n’en fallait pour la rédaction de mon article.
De retour à l’auberge de l’Aigle, j’allais monter dans ma chambre lorsque j’entrevis, dans la salle à boire, Julien Beausire derrière sa table habituelle. Appelez ça déformation professionnelle, ou curiosité malsaine (mais peut-être est-ce la même chose ?), je ne pus m’empêcher de l’approcher à nouveau.
— Eh bien, Beausire, dis-je, comment allez-vous aujourd’hui ?
Il me dévisagea comme s’il me voyait pour la première fois. Je lui rappelai mon nom, notre conversation de la veille, et mon article sur la foire agricole. Il se détendit.
— Bien sûr, bien sûr, M. xxxx, dit-il. Où avais-je la tête. J’espère que votre journée a été productive.
Puis il replongea le nez dans son journal. Je restai quelques instants debout, les bras ballants, attendant que Beausire me témoignât à nouveau son intérêt, mais le savant semblait avoir oublier ma présence.
Je m’installai au bar et commandai à boire.
— Il est comme ça, me dit le patron en posant un demi devant moi. Il lui arrive, d’un jour à l’autre, d’oublier des conversations, ou même des personnes. Le pauvre diable ! Je vous l’ai dit, il n’a plus toute sa tête.
Je m’étais tourné, la salle à boire ne comptait que quelques clients, dont un groupe de joueurs de belote. Je gardai un œil sur Beausire, qui lisait studieusement son journal. J’encourageai le patron à m’en dire plus.
Tout avait commencé quelques jours après la mort de madame Beausire, qui n’avait même pas encore été mise en terre. Le savant était entré et s’était installé à la table qu’il occupait à cet instant. Il attendait, sans rien dire. Quand le patron vint prendre sa commande, il eut l’air surpris. Puis Beausire lui demanda de lui apporter le journal, mais pas n’importe lequel, celui de l’avant-veille. Le patron avait fouillé dans sa corbeille de vieux papier pour en extirper l’édition, sur lequel le savant s’était jeté. Quelques minutes dans sa lecture, il avait poussé un cri.
— Il était très excité. Il m’a montré une page du journal. On y relatait l’accident de chemin de fer qui avait couté la vie à sa femme. Il m’a alors attrapé par le bras, soudain sérieux comme un pape, puis il m’a glissé cinq mille francs dans la main. Dorénavant, m’a-t-il dit, il faudrait que je conserve pour lui le journal de l’avant-veille, qu’il viendrait consulter chaque jour à la même heure. Cinq mille francs, vous vous rendez compte ! Je ne pouvais pas dire non.
J’éprouvai tout à coup de curieuses sensations : une gorge sèche et un sol trop mou sous mes semelles. Je regardai Beausire, qui tournait les pages du journal, plissant ses petits yeux presbytes pour déchiffrer de trop petits caractères. Je me remémorai les mots qu’il avait prononcés la veille, avant que nous nous quittions : « Le futur sera ce qu’il sera, mais le passé, mon cher, c’est une autre histoire ! »
FIN