Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, de Haruki Murakami, est un livre de mémoires se focalisant sur la course à pied, son sport favori. Murakami est bien sûr un écrivain de légende, un inclassable, un littéraire qui a néanmoins remporté le World Fantasy Award pour Kafka sur le rivage – et encore un écrivain que je n’avais jusqu’ici jamais lu.
Cela peut paraître un choix étrange pour une première lecture, cet autoportrait, publié en français en 2009. La vérité est que j’avais gardé en mémoire une critique de ce livre dans le Masque et la Plume, datant donc probablement de 2009 ou 2010, qui m’avait beaucoup intéressée. Une autre raison est que la course à pied est le maigre sport que je pratique un tant soit peu, quoiqu’à un niveau se situant à un ou deux ordres de grandeur en dessous de celui de Murakami. Néanmoins, je me sentais donc prêt à me lancer dans ses mémoires d’un écrivain coureur.
Bien m’en a pris car le livre est très bon. Murakami a un style en un sens naturaliste, s’attachant à décrire les choses sans trop d’effets, ou alors des effets disséminés en douce, sans ostentation. Il y a une volonté d’honnêteté, de matter-of-fact. On peut s’aventurer dans la pyschologie, mais cela ne domine pas. (Est-ce là la manière japonaise ? À vrai dire je n’y connais pas grand-chose.) On apprendra également que Murakami est fan de Raymond Carver, et que le titre original, qui peut se traduire littéralement par « Ce dont je parle quand je parle de courir », est un clin d’œil au recueil de Carver « What we talk about when we talk about love ».
Et puis, on s’amuse beaucoup à lire Murakami dézinguer quelques clichés sur la course et son apport à la création :
« On m’a souvent demandé à quoi je pensais lorsque je courais. En général, les gens qui me posent cette question n’ont jamais participé eux-mêmes à des courses de fond. À quoi exactement est-ce que je pense lorsque je cours ? Eh bien, je n’en sais rien. Quand il fait froid, je suppose que je pense vaguement qu’il fait froid. Et s’il fait chaud, je dois penser vaguement à la chaleur. Quand je suis triste, je pense à la tristesse. Si je suis content, je pense au bonheur. Comme je l’ai déjà dit, des souvenirs m’assaillent aussi, un peu au hasard. Et il m’arrive parois, enfin, presque jamais en fait, d’avoir une idée que j’utiliserai dans un roman. En réalité, quand je cours, je ne pense à rien qui vaille la peine d’être noté. »
Haruki Murakami, Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, p. 28
Murakami écrit aussi des pages très belles sur l’inévitable déclin du corps, qu’il mesure avec précision à l’aune de ses performances sportives. Si l’on a la chance de ne pas mourir jeune, nous déclinerons physiquement avec l’âge, c’est inévitable et il faut l’accepter. Un état d’esprit qui raisonnera chez tous les adeptes du stoïcisme (je m’inclus volontiers dans le lot).
Mais là où Murakami est à mon avis le plus intéressant, c’est dans le parallèle qu’il tire entre l’entraînement physique et l’activité d’écrivain. Car écrire, dit-il, est une activité physique autant que mentale. Focaliser sa concentration, toute son activité cérébrale, seul assis à une table, souvent durant plusieurs heures d’affilée, rien de ça n’est une mince affaire. Cela se travaille, cela s’entraîne, petit à petit. Cela requiert des efforts, du temps, et de la préparation, et de même qu’un coureur amateur ne se jette pas tout de suite dans un marathon, un auteur novice aura du mal à tenir la distance sur un roman. D’où l’idée, également, que les auteurs puissent souffrir d’épuisement physique, et que certains n’ont plus la force, passé un certain âge, d’accomplir de grandes œuvres. (Mais il y a des exceptions, nous rassure Murakami. Tolstoï et Dostoïevski ont écrit certains de leurs plus grands livres après cinquante ans !…)
On parle souvent du « souffle » d’un écrivain. Murakami pousse la métaphore encore plus loin. Ou, pour être exact, pour lui il ne s’agit plus d’une métaphore, mais bien d’une similarité entre l’activité de courir et celle d’écrire. Il y a le souffle, mais aussi le rythme :
« Si j’ai envie d’accélérer, je m’accorde une pointe de vitesse ; en augmentant mon allure, je réduis ma durée de course, mais je m’efforce de garder intacte pour le lendemain la jubilation qu’éprouve mon corps aujourd’hui. C’est la même chose, et c’est essentiel, lorsque j’écris une nouvelle. Au moment où je sens que je pourrais continuer à écrire, je pose mon stylo, je m’arrête. Ainsi, le travail du jour suivant s’enclenchera aisément. Je crois qu’Ernest Hemingway écrivait de manière similaire. Pour poursuivre une activité, il faut conserver son rythme. Ce qui est particulièrement important pour des tâches de longue haleine. Une fois que vous tenez le bon rythme, tout va bien. Mais avant que le volant d’une machine ne se mette à tourner à une vitesse constante, de manière sûre, il faut beaucoup d’efforts, ni trop, ni trop peu, pour parvenir à cette obstination, cette régularité. »
Haruki Murakami, Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, p. 13
Si l’on arrête l’activité physique pendant longtemps, on ne peut pas immédiatement s’y remettre, du moins pas au niveau le plus élevé que l’on avait atteint. Pareil pour l’écriture. J’ai mieux compris cela lorsque je me suis remis à écrire de la fiction après une longue pause, même si bien entendu mon activité reste à un niveau très modeste (disons que je cours plutôt des 5 km, et non des marathons). Mes premières tentatives de reprise ont ainsi été frustrantes : les muscles étaient atrophiés et la machine mal graissée. Ça se traînait. Ça n’avançait pas. Je commençais des textes, puis les abandonnais quelques mois plus tard, comme de la poussière glissée en douce sous le tapis. Petit à petit, à force de travail, j’ai retrouvé un semblant de rythme. J’ai terminé des histoires – pas nécessairement très bonnes, mais là n’était pas l’essentiel.
Belle leçon de persistence, cet autoportrait. Comme disait l’autre : Patience et longueur de temps…
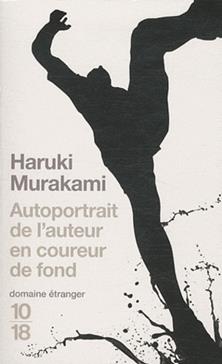
- Autoportrait de l’auteur en coureur de fond, de Haruki Murakami, 2011, Editions 10/18, 220 pages.

